
















































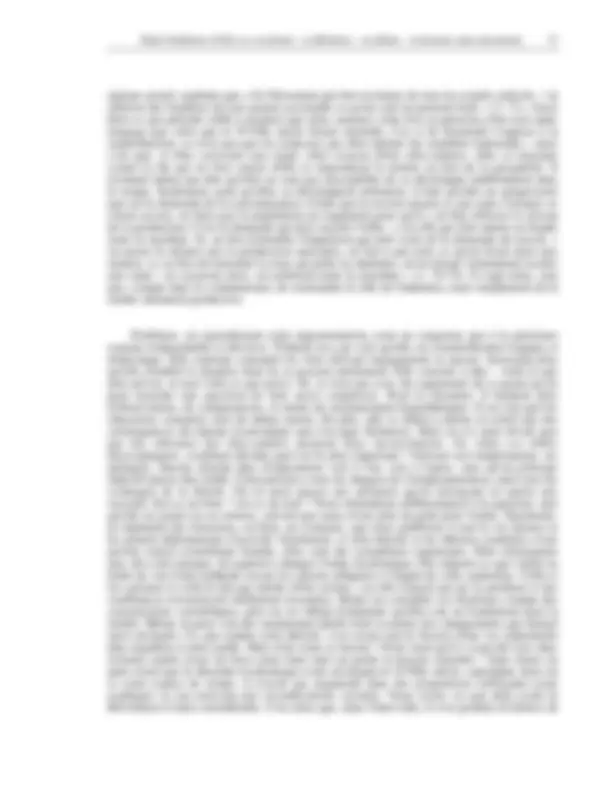













































Study with the several resources on Docsity

Earn points by helping other students or get them with a premium plan


Prepare for your exams
Study with the several resources on Docsity

Earn points to download
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Community
Ask the community for help and clear up your study doubts
Discover the best universities in your country according to Docsity users
Free resources
Download our free guides on studying techniques, anxiety management strategies, and thesis advice from Docsity tutors
Originaire du socialisme et ses début en Europe et dans le monde
Typology: Thesis
1 / 159

This page cannot be seen from the preview
Don't miss anything!

















































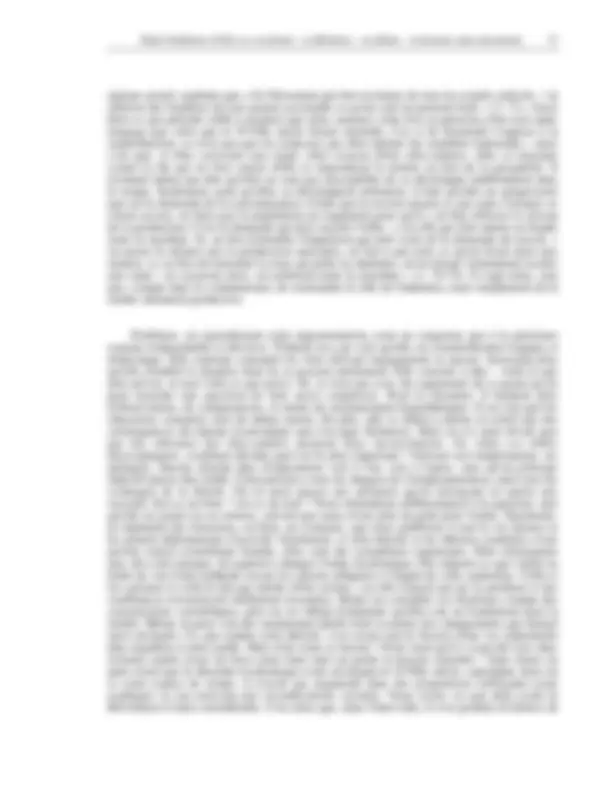











































Le
socialisme
- la doctrine saint-simonienne
Un document produit en version numérique par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi Courriel: jmt_sociologue@videotron.ca Site web: http://pages.infinit.net/sociojmt
Dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales" Site web: http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html
Une collection développée en collaboration avec la Bibliothèque Paul-Émile-Boulet de l'Université du Québec à Chicoutimi Site web: http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm
Cette édition électronique a été réalisée par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi Le 15 février 2002 à partir de :
Émile DURKHEIM (1928)
Le socialisme. Sa définition - Ses débuts - La doctrine Saint-Simonienne (1928)
Une édition électronique réalisée à partir du livre d’Émile Durkheim, Le socialisme. Sa définition – Ses débuts – La doctrine Saint-Simonienne.
Polices de caractères utilisée :
Pour le texte: Comic Sans, 12 points. Pour les citations : Comic Sans 10 points. Pour les notes de bas de page : Comic sans, 10 points.
Édition électronique réalisée avec le traitement de textes Microsoft Word 2001 pour Macintosh.
Mise en page sur papier format LETTRE (US letter), 8.5’’ x 11’’)
CHAPITRE VIII. La doctrine de Saint-Simon(suite). - Organisation du système industriel
Leçon 8 (fin) Leçon 9 Leçon 10
CHAPITRE IX. La doctrine de Saint-Simon(fin). - L'internationalisme et la religion
Leçon 11 Leçon 12
CHAPITRE X. Saint-Simon(fin). - Conclusions critiques Leçon 12 (fin)
CHAPITRE XI. L'École saint-simonienne. - Conclusions critiques du cours
Leçon 13 Leçon 14
CONCLUSIONS DU COURS
Une édition électronique produite à partir de l’ouvrage d’Émile Durkheim (1928) intitulé :
LE SOCIALISME SA DÉFINITION - SES DÉBUTS LA DOCTRINE SAINT-SIMONIENNE
L'idée était d'ailleurs si importante qu'elle frappa les esprits. Ainsi Georges Sorel, esprit pénétrant, sinon érudit et juste, que nous connaissions depuis 1893, ne manqua pas de l'utiliser dans plusieurs articles du Devenir social. Plus tard le syndicalisme révolutionnaire s'est en partie nourri d'elle. Que ceci soit noté en passant et pour marquer un simple point d'histoire. Nous aurions fort à dire à ce sujet. Car, en cette affaire, nous Mines, un certain nombre d'entre nous du moins, plus que des témoins, de 1893 à 1906.
Cependant, jusqu'en 1895, Durkheim ne put pas distraire un instant de ses travaux pour revenir à l'étude du socialisme. D'ailleurs même alors, quand il y revint, comme on le verra dans ce livre, il ne se départit pas de son point de vue habituel. Il considéra cette doctrine d'un point de vue purement scientifique, comme un fait que le savant doit envisager froidement, sans préjugé, sans prendre parti. C'est le problème sociologique qu'il traite : pour lui, il s'agit d'expliquer une idéologie, l'idéologie socialiste ; et pour l'expliquer, il faut analyser les faits sociaux qui ont obligé quelques hommes comme Saint-Simon et Fourier, comme Owen et Marx à dégager des principes nouveaux de morale et d'action politique et économique. Ce cours d'ailleurs est, croyons-nous, un modèle d'application d'une méthode sociologique et historique à l'analyse des causes d'une idée.
Mais, sous cette forme désintéressée de recherche, Durkheim satisfaisait un besoin de sa pensée morale et scientifique à la fois. Il cherchait à prendre parti et à motiver ce parti. Il y était incliné par une série d'événements, quelques-uns petits et personnels, quelques autres plus graves. Il se heurtait au reproche de collectivisme que lui assénèrent, à propos de sa Division du travail, des moralistes susceptibles et plusieurs économistes classiques ou chrétiens. Grâce à des bruits de ce genre, on l'écartait des chaires parisiennes. D'autre part, parmi ses propres étudiants, quelques-uns des plus brillants s'étaient convertis au socialisme, plus spécialement marxiste, voire guesdiste. Dans un Cercle d'Études sociales, quelques-uns commentaient Le Capital de Marx comme ailleurs ils commentaient Spinoza. Durkheim sentait cette opposition au libéralisme et à l'individualisme bourgeois. Dans une conférence organisée à Bordeaux, par ce Cercle et par le Parti ouvrier, Jaurès, dès 1893, glorifiait l'œuvre de Durkheim. D'ailleurs, si c'est Lucien Herr qui, en 1886-1888, convertit Jaurès au socia- lisme, c'est Durkheim qui, en 1885-1886, avait détourné celui-ci du formalisme politique et de la philosophie creuse des radicaux.
Durkheim connaissait assez bien le socialisme dans les sources elles-mêmes : par Saint- Simon, par Schaeffle, par Karl Marx, qu'un ami finlandais, Neiglick, lui avait appris à étudier pendant son séjour à Leipzig. Toute sa vie, il n'a répugné à adhérer au socialisme proprement dit qu'à cause de certains traits de cette action : son caractère violent ; son caractère de classe, plus ou moins purement ouvriériste, et aussi son caractère politique et même politicien. Durkheim était profondément opposé à toute guerre de classes ou de nations ; il ne voulait de changement qu'au profit de la société tout entière et non d'une de ses fractions, même si celle- ci était le nombre et avait la force ; il considérait les révolutions politiques et les évolutions parlementaires comme superficielles, coûteuses et plus théâtrales que sérieuses. Il résista donc toujours à l'idée de se soumettre à un parti de discipline politique, surtout international. Même la crise sociale et morale de l'affaire Dreyfus, où il prit une grande part, ne changea pas son opinion. Même pendant la guerre, il fut de ceux qui ne mirent aucun espoir dans ce qu'on appelle la classe ouvrière organisée internationalement. Il resta donc toujours dans un juste milieu ; il « sympathisa », comme on dit maintenant, avec les socialistes, avec Jaurès, avec le socialisme. Il ne s'y donna jamais.
Pour se justifier à ses propres yeux, à ceux de ses étudiants et, un jour, à l'égard du monde, il commença donc ces études. Le cours publie eut un succès très grand. La définition du socialisme qui fut publiée en résumé frappa Guesde et Jaurès qui se dirent d'accord avec Durkheim. Celui-ci préparait pour 1896-1897 un cours sur Fourier et sur Proudhon dont il possédait et avait étudié les oeuvres, comme il avait fait pour celles de Saint-Simon et des saint-simoniens. Il eût consacré une troisième année à Lassalle qu'il connaissait peu alors, à Marx et au socialisme allemand qu'il connaissait bien déjà. Il avait d'ailleurs l'intention de s'en tenir à l’œuvre des maîtres, à leur pensée, plus qu'au train de vie des individus et qu'aux événements de second rang.
Mais dès 1896, Durkheim, entreprenant L'Année sociologique, revint à la science pure ; l'Histoire du socialisme est restée inachevée. Il regretta toujours de n'avoir pu la continuer et de ne pouvoir la reprendre.
Ce livre ne contient donc que la première partie : Définition, Débuts du socialisme, Saint-Simon. De plus il arrive un peu tard. Mais à l'époque où Durkheim l'enseigna, l'histoire des doctrines socialistes n'était guère en honneur, ni n'était bien pratiquée. Les choses ont changé. Bourguin, MM. Gide et Rist ont fait leur œuvre. Le socialisme est là, force ouvrière et force politique, qui s'impose. Son histoire fait vivre d'innombrables auteurs. Saint-Simon est à la mode et même, après la guerre, tout le monde, peu ou prou, s'est dit saint-simonien. Le centenaire du premier messie socialiste a été décemment célébré.
Nombre de travaux ont élucidé bien des questions que Durkheim ne prétendit pas résoudre et qu'il ne soupçonnait même pas. Le livre de M. Charléty sur Saint-Simon et les saint-simoniens est fait avec toutes les ressources de l'histoire moderne. Et la belle Introduction que MM. C. Bouglé et Elie Halévy ont mise à l'Exposition de la doctrine de Saint-Simon, par Bazard et les autres, instruit très suffisamment sur les sources et les détails. L’œuvre biographique de M. Georges Dumas et de M. Maxime Leroy n'est même pas pressentie par ce cours.
Nous le publions cependant. D'abord, il expose une précieuse et classique définition du socialisme. Ensuite - ou nous nous trompons fort - aucun exposé d'ensemble des débuts du socialisme ne lui est comparable en clarté et en force. Enfin, l'opinion critique ou historique de Durkheim (par exemple à propos des origines de la sociologie) a sans doute, en elle- même, un intérêt philosophique, et vaut peut-être même un fait.
Une partie de ces leçons a paru dans la Revue de Métaphysique et de Morale et dans la Revue philosophique. Nous remercions les éditeurs de ces revues qui nous permettent de les reproduire ici.
Le manuscrit est fort soigné, très peu de passages sont restés illisibles. Nous n'avons pas cherché à combler ces vides. Toute altération est signalée entre crochets. Nous avons vérifié les citations et n'avons apporté de changements au texte que pour marquer des titres de chapitres. Nous avons aussi dû découper quelques leçons. Les redîtes du cours n'ont pas été touchées. Le manuscrit est divisé en leçons. C'est nous qui les avons quelquefois découpées et qui avons constitué les chapitres et les livres, sans difficultés. Tous les titres sont de Durkheim.
. Å
. Å
PREMIÈRE LEÇON
On peut concevoir deux manières très différentes d'étudier le socialisme. On peut y voir une doctrine scientifique sur la nature et l'évolution des sociétés en général et, plus spécialement, des sociétés contemporaines les plus civilisées. Dans ce cas, l'examen qu'on en fait ne diffère pas de celui auquel les savants soumettent les théories et les hypothèses de leurs sciences respectives. On le considère dans l'abstrait, en dehors du temps et de l'espace, en dehors du devenir historique, non comme un fait dont on entreprend de retrouver la genèse, mais comme un système de propositions qui expriment ou sont censées exprimer des faits, et on se demande ce qu'il a de vrai et de faux, s'il est conforme ou non à la réalité sociale, dans quelle mesure il est d'accord avec lui-même et avec les choses. C'est la méthode, par exemple, qu'a suivie M. Leroy-Beaulieu dans son livre sur le Collectivisme. Tel ne sera pas notre point de vue. La raison en est que, sans diminuer pour autant l'importance et l'intérêt du socialisme, nous ne saurions lui reconnaître un caractère proprement scientifique. En effet, une recherche ne peut être appelée de ce nom que si elle a un objet actuel, réalisé, qu'elle a simplement pour but de traduire en un langage intelligible. Une science, c'est une étude portant sur une portion déterminée du réel qu'il s'agit de connaître et, si possible, de comprendre. Décrire et expliquer ce qui est et ce qui a été, telle est son unique tâche. Les spéculations sur l'avenir ne sont pas son fait, quoiqu'elle ait pour dernier objectif de les rendre possibles.
Or, tout au rebours, le socialisme est tout entier orienté vers le futur. C'est avant tout un plan de reconstruction des sociétés actuelles, un programme d'une vie collective qui n'existe pas encore ou qui n'existe pas telle qu'elle est rêvée, et qu'on propose aux hommes comme digne de leurs préférences. C'est un idéal. Il s'occupe beaucoup moins de ce qui est ou a été que de ce qui doit être. Sans doute, jusque sous ses formes les plus utopiques, il n'a jamais dédaigné l'appui des faits et, même, dans les temps les plus récents, il a de plus en plus affecté une certaine tournure scientifique. Il est incontestable que, par là, il a rendu à la science sociale plus de services peut-être qu'il n'en a reçu. Car il a donné l'éveil à la réflexion, il a stimulé l'activité scientifique, il a provoqué des recherches, posé des problèmes, si bien que, par plus d'un point, son histoire se confond avec l'histoire même de la sociologie. Seulement, comment n'être pas frappé de l'énorme disproportion qu'il y a entre les rares et maigres données qu'il emprunte aux sciences et l'étendue des conclusions pratiques qu'il en
montrer par le côté où il ne présente qu'un médiocre intérêt. Quiconque a conscience de ce que doit être la science sociale, de la lenteur de ses procédés, des laborieuses investigations qu'elle suppose pour résoudre même les questions les plus restreintes, ne peut pas être bien curieux de ces solutions hâtives et de ces vastes systèmes si sommairement ébauchés. On sent trop l'écart qu'il y a entre la simplicité des moyens mis en oeuvre et l'ampleur des résultats, et l'on est porté par suite à dédaigner ces derniers. Mais le socialisme peut être examiné sous un tout autre aspect. S'il n'est pas une expression scientifique des faits sociaux, il est lui-même un fait social et de la plus haute importance. S'il n'est pas oeuvre de science, il est objet de science. Celle-ci n'a pas à s'en occuper pour lui emprunter telle ou telle proposition toute faite, mais pour le connaître, pour savoir ce qu'il est, d'où il vient, où il tend.
Pour une double raison, il est intéressant à étudier de ce point de vue. D'abord, on peut espérer qu'il nous aidera à comprendre les états sociaux qui l'ont suscité. Car précisément parce qu'il en dérive, il les manifeste et les exprime à sa façon, et, par cela même, il nous donne un moyen de plus pour les atteindre. Ce n'est pas assurément qu'il les reflète avec exactitude. Tout au contraire, pour les motifs que nous avons dits plus haut, on peut être certain qu'il les réfracte involontairement et ne nous en donne qu'une expression infidèle, de même que le malade interprète mal les sensations qu'il éprouve et les attribue le plus souvent à une cause qui n'est pas la vraie. Mais ces sensations mêmes, telles qu'elles sont, ont leur intérêt, et le clinicien les relève avec soin et en tient grand compte. Elles sont un élément du diagnostic et un élément fort important. Par exemple, il n'est pas indifférent de savoir où elles sont ressenties, quand elles ont débuté. De même, il importe au plus haut point de déterminer l'époque où le socialisme a commencé à se produire. C'est un cri de détresse collective, disions-nous, eh bien! il est essentiel de fixer le moment où ce cri a été poussé pour la première fois. Car, suivant qu'on y verra un fait récent qui tient à des conditions toutes nouvelles de la vie collective, ou, au contraire, une simple réédition, une variante tout au plus des plaintes que les misérables de toutes les époques et de toutes les sociétés ont fait entendre, des éternelles revendications des pauvres contre les riches, on jugera tout autrement des tendances que le socialisme manifeste. Dans le second cas, on sera porté à croire qu'elles ne peuvent pas plus aboutir que la misère humaine ne peut finir ; on les considérera comme une sorte de mal chronique de l'humanité qui, de temps en temps, au cours de l'histoire, sous l'influence de circonstances passagères, semble devenir plus aigu et plus douloureux, mais qui finit toujours par s'apaiser à la longue, et alors on s'attachera uniquement à chercher quelques calmants pour l'endormir à nouveau. Si, au contraire, on trouve qu'il est de date récente, qu'il tient à une situation sans analogue dans l'histoire, on ne peut plus conclure à sa chronicité, et il est moins aisé d'en prendre son parti. Mais ce n'est pas seulement pour déterminer la nature du mal que cette étude du socialisme promet d'être instructive, c'est aussi pour trouver les remèdes appropriés. Assurément on peut être certain par avance que ce n'est identiquement aucun de ceux que réclament les systèmes, de même que la boisson réclamée par le fiévreux n'est pas celle qui lui convient. Mais, d'un autre côté, les besoins qu'il ressent ne laissent pas de guider le traitement. Ils ne sont jamais sans quelque cause, et parfois même il arrive que le mieux est de les satisfaire. De même et pour la même raison, il importe de savoir quels sont les réarrangements sociaux, c'est-à-dire les remèdes dont les masses souffrantes de la société ont eu spontanément et instinctivement l'idée, si peu scientifique qu'en ait été l'élaboration. Or, c'est là ce qu'expriment les théories socialistes. Les indications que l'on peut recueillir à ce sujet seront surtout utiles si, au lieu de s'enfermer dans un système, on fait une étude largement comparative de toutes les doctrines. Car alors on a plus de chances pour éliminer de toutes ces aspirations ce qu'elles ont nécessairement d'individuel, de subjectif, de contingent, pour n'en dégager et n'en retenir que leurs caractères les plus généraux, les plus impersonnels, partant les plus objectifs.
Non seulement un tel examen a son utilité, mais il semble bien devoir être autrement plus fécond que celui auquel on soumet le plus ordinairement le socialisme. Quand on ne l'étudie que pour le discuter à un point de vue doctrinal, comme il ne repose que sur une science très imparfaite, il est aisé de montrer combien il dépasse les faits mêmes sur lesquels il s'appuie, ou de leur opposer des faits contraires, de relever en un mot toutes ses imperfections théoriques. On peut ainsi, sans beaucoup de peine, passer en revue tous les systèmes ; il n'en est pas dont la réfutation ne soit relativement facile, parce qu'il n'en est pas qui soient scientifiquement fondés. Seulement, si savante, si bien conduite qu'elle soit, une telle critique reste superficielle, car elle passe à côté de ce qui est essentiel. Elle s'attache uniquement à ce qui est la forme extérieure et apparente du socialisme et, par suite, n'aperçoit pas ce qui en fait le fond et la substance, à savoir cette diathèse collective, ce malaise profond dont les théories particulières ne sont que des syndromes et comme des manifestations épisodiques et à fleur de peau. Quand on s'est bien escrimé contre Saint-Simon, Fourier ou Karl Marx, on n'est pas renseigné pour autant sur l'état social qui les a suscités les uns et les autres, qui a été et qui est encore leur raison d'être, qui demain suscitera d'autres doctrines si celles-là tombent dans le discrédit. Aussi toutes ces belles réfutations sont un véritable travail de Pénélope, sans cesse à recommencer, car elles n'atteignent le socialisme que du dehors, et car le dedans leur échappe. Elles s'en prennent aux effets, non aux causes. Or ce sont les causes qu'il faut atteindre, ne serait-ce que pour bien comprendre les effets. Mais, pour cela, il ne faut pas considérer le socialisme dans l'abstrait, en dehors de toute condition de temps et de lieu, il faut, au contraire, le rattacher aux milieux sociaux où il a pris naissance ; il faut ne pas le soumettre à une discussion dialectique, mais en faire l'histoire.
C'est à ce point de vue que nous allons nous placer. Nous allons envisager le socialisme comme une chose, comme une réalité, et nous tâcherons de la comprendre. Nous nous efforcerons de déterminer en quoi il consiste, quand il a commencé, par quelles transforma- tions il a passé et ce qui a déterminé ces transformations. Une recherche de ce genre ne diffère donc pas sensiblement de celles que nous avons faites les années précédentes. Nous allons étudier le socialisme comme nous avons fait pour le suicide, la famille, le mariage, le crime, la peine, la responsabilité et la religion 1. Toute la différence, c'est que nous allons nous trouver cette fois en présence d'un fait social qui, étant tout récent, n'a encore qu'un développement très court. Il en résulte que le champ des comparaisons possibles est très restreint, ce qui rend le phénomène plus difficile à bien connaître, d'autant plus qu'il est très complexe. Aussi, pour en avoir une intelligence plus complète, il ne sera pas inutile de le rapprocher de certaines informations que nous devons à d'autres recherches. Car cet état social auquel correspond le socialisme ne se présente pas à nous pour la première fois. Nous l'avons rencontré, au contraire, c'est-à-dire toutes les fois que nous avons pu suivre jusqu'aux temps contemporains les phénomènes sociaux dont nous nous occupions, au terme de chacune de nos études antérieures. Il est vrai que nous n'avons pu l'atteindre ainsi que d'une manière fragmentaire ; et même le socialisme en un sens ne nous permettrait-il pas mieux de le saisir dans son ensemble, parce qu'il l'exprime en bloc, pour ainsi dire? Nous n'en pourrons pas moins utiliser à l'occasion les résultats partiels que nous avons obtenus.
Mais, pour pouvoir entreprendre cette étude, il nous faut avant tout déterminer l'objet sur lequel elle va porter. Il ne suffit pas de dire que nous allons considérer le socialisme comme une chose. Il nous faut de plus indiquer à quels signes on reconnaît cette chose, c'est-à-dire en donner une définition qui nous permette de l'apercevoir partout où elle se rencontre et de ne pas la confondre avec ce qui n'est pas elle.
(^1) Allusion aux cours que Durkheim avait professés à Bordeaux de 1887 à 1895. (M. M.)
socialisme (p. 2), que, pour bien établir que la Révolution française n'a eu aucun caractère socialiste, il suffit de faire voir « qu'elle n'a pas violé le principe de la propriété ». Et pourtant on peut dire qu'il n'y a pas une seule doctrine socialiste à laquelle une telle définition s'applique. Considérons, par exemple, celle qui restreint le plus la propriété privée, la doctri- ne collectiviste de Karl Marx. Elle retire bien aux individus le droit de posséder les instru- ments de production, mais non toute espèce de richesses. Ils conservent un droit absolu sur les produits de leur travail. Cette atteinte limitée au principe de la propriété individuelle peut- elle du moins être regardée comme caractéristique du socialisme? Mais notre organisation économique actuelle présente des restrictions du même genre et ne se distingue à cet égard du marxisme que par une différence de degrés. Est-ce que tout ce qui est directement ou indi- rectement monopole de l'État n'est pas retiré du domaine privé? Chemins de fer, postes, tabacs, fabrication des monnaies, poudres, etc., ne peuvent être exploités par des particuliers, ou ne peuvent l'être qu'en vertu d'une concession expresse de l'État. Dira-t-on que, effecti- vement, le socialisme commence là où commence la pratique des monopoles? Alors, il faut le mettre partout ; il est de tous les temps et de tous les pays, car il n'y a jamais eu de société sans monopole. C'est dire qu'une telle définition est beaucoup trop étendue. Il y a plus ; bien loin qu'il nie le principe de la propriété individuelle, le socialisme peut, non sans raison, prétendre qu'il en est l'affirmation la plus complète, la plus radicale qui en ait jamais été faite. En effet, le contraire de la propriété privée, c'est le communisme ; or, il y a encore dans nos institutions actuelles un reste du vieux communisme familial, c'est l'héritage. Le droit des parents à se succéder les uns aux autres dans la propriété de leurs biens n'est que le dernier vestige de l'ancien droit de copropriété que, jadis, tous les membres de la famille avaient collectivement sur l'ensemble de la fortune domestique. Or, un des articles qui revient le plus souvent dans les théories socialistes, c'est l'abolition de l'héritage. Une telle réforme aurait donc pour effet d'affranchir l'institution de la propriété individuelle de tout alliage communiste, par conséquent de la rendre plus vraiment elle-même. En d'autres termes, on peut raisonner ainsi : pour que la propriété puisse être vraiment dite individuelle, il faut qu'elle soit l’œuvre de l'individu et de lui seul. Or, le patrimoine transmis par héritage n'a pas ce caractère : c'est seulement une oeuvre collective appropriée par un individu. La propriété individuelle, peut-on dire encore, est celle qui commence avec l'individu pour finir avec lui ; or, celle qu'il reçoit en vertu du droit successoral existait avant lui et s'est faite sans lui. En reproduisant ce raisonnement, je n'entends pas d'ailleurs défendre la thèse des socialistes, mais montrer qu'il y a du communisme chez leurs adversaires et que ce n'est pas par là, par conséquent, qu'il est possible de les définir.
Nous en dirons autant de cette conception, non moins répandue, d'après laquelle le socialisme consisterait dans une étroite subordination de l'individu à la collectivité. « Nous pouvons définir comme socialiste, dit Adolphe Held, toute tendance qui réclame la subordi- nation du bien individuel à la communauté. » De même Roscher, mêlant un jugement, une critique à sa définition, appelle socialistes les tendances « qui réclament une considération du bien commun supérieure à ce que permet la nature humaine ». Mais il n'y a pas eu de société où les biens privés n'aient été subordonnés aux fins sociales ; car cette subordination est la condition même de toute vie commune. Dira-t-on, avec Roscher, que l'abnégation que nous demande le socialisme a ceci de caractéristique qu'elle dépasse nos forces? C'est apprécier la doctrine et non la définir, et une telle appréciation ne peut servir de critère pour la distinguer de ce qui n'est pas elle, car elle laisse trop de place à l'arbitraire. Cette limite extrême des sacrifices que tolère l'égoïsme individuel ne peut être déterminée objectivement. Chacun l'avance ou la recule suivant son humeur. Chacun, par conséquent, serait libre d'entendre le socialisme à sa façon. Il y a plus : cette soumission de l'individu au groupe est si peu dans l'esprit de certaines écoles socialistes et des plus importantes qu'elles ont plutôt une tendance à l'anarchie. C'est le cas notamment du fouriérisme et du mutuellisme de Proudhon, où l'individualisme est systématiquement poussé jusqu'à ses conséquences les plus paradoxales.
Le marxisme lui-même ne se propose-t-il pas, suivant un mot célèbre d'Engels, la destruction de l'État comme État? A tort ou à raison, Marx et ses disciples estiment que, du jour où l'organisation socialiste sera constituée, elle pourra fonctionner d'elle-même, automatique- ment, sans aucune contrainte, et nous retrouverons déjà cette idée dans Saint-Simon. En un mot, s'il y a un socialisme autoritaire, il y en a un aussi qui est essentiellement démocratique. Comment, en effet, en serait-il autrement? Il est, comme nous le verrons, sorti de l'indivi- dualisme révolutionnaire, tout comme les idées du XIXe siècle sont sorties de celles du XVIIIe et, par conséquent, il ne peut pas ne pas porter la trace de ses origines. Reste, il est vrai, la question de savoir si ces tendances différentes sont susceptibles de se concilier logiquement. Mais nous n'avons pas pour l'instant à estimer la valeur logique du socialisme. Nous cherchons seulement à savoir en quoi il consiste.
Mais il y a une dernière définition qui paraît plus adéquate à l'objet défini. Très souvent, sinon toujours, le socialisme a eu pour but principal d'améliorer la condition des classes laborieuses en introduisant plus d'égalité dans les relations économiques. C'est pourquoi on l'appelle la philosophie économique des classes qui souffrent. Mais à elle seule cette tendance ne suffit pas à le caractériser, car elle ne lui est pas propre. Les économistes, eux aussi, aspirent à une moindre inégalité dans les conditions sociales ; ils croient seulement que ce progrès peut et doit se faire par le jeu naturel de l'offre et de la demande et que toute intervention législative est inutile. Dirons-nous alors que ce qui distingue le socialisme, c'est qu'il veut obtenir ce même résultat par d'autres moyens, à savoir par l'action de la loi? C'était la définition de Laveleye. « Toute doctrine socialiste, dit-il, vise à introduire plus d'égalité dans les conditions sociales et, secondement, à réaliser ces réformes par l'action de la loi ou de l'État. » Mais, d'une part, si cet objectif est effectivement un de ceux que poursuivent les doctrines, il s'en faut que ce soit le seul. Le rattachement à l'État des grandes industries, des grandes exploitations économiques qui, par leur importance, embrassent toute la société, mines, chemins de fer, banques, etc., ont pour but de protéger les intérêts collectifs contre certaines influences particulières, non d'améliorer le sort des travailleurs. Le socialisme dépasse la question ouvrière. Même dans certains systèmes, celle-ci n'occupe qu'une place assez secondaire. C'est le cas de Saint-Simon, c'est-à-dire du penseur que l'on s'accorde à regarder comme le fondateur du socialisme. C'est le cas aussi des socialistes de la Chaire, qui sont beaucoup plus préoccupés de sauvegarder les intérêts de l'État que de protéger les déshérités de la fortune. D'un autre côté, il est une doctrine qui vise à réaliser cette égalité beaucoup plus radicalement que le socialisme : c'est le communisme, qui nie toute propriété individuelle et, par cela même, toute inégalité économique. Or, quoique la confusion ait été souvent commise, il est impossible d'en faire une simple variété du socialisme. Nous aurons prochainement à revenir sur la question. Platon et Morus, d'une part, et Marx de l'autre, ne sont pas des disciples d'une même école. A priori même, il n'est pas possible qu'une organi- sation sociale imaginée en vue des sociétés industrielles que nous avons actuellement sous les yeux ait été déjà conçue, alors que ces sociétés n'étaient pas nées. Enfin, il est bien des mesures législatives que l'on ne saurait regarder comme exclusivement socialistes et qui pourtant ont pour effet de diminuer l'inégalité des conditions sociales. L'impôt progressif sur les héritages et sur les revenus a nécessairement ce résultat, et pourtant n'est pas un apanage du socialisme. Que doit-on dire des bourses accordées par l'État, des institutions publiques de bienfaisance, de prévoyance, etc. Si on les qualifie de socialistes, comme il arrive quelque- fois, au cours des discussions courantes, le mot perd toute espèce de sens, tant il prend une acception étendue et indéterminée.
On voit à quoi on s'expose quand, pour trouver la définition du socialisme, on se contente d'exprimer avec quelque précision l'idée qu'on s'en fait. On le confond alors avec tel ou tel aspect particulier, telle ou telle tendance spéciale de certains systèmes, simplement
si, par les transformations économiques réclamées par les différentes sectes réformistes, il n'y en a pas qui soient distinctives du socialisme.
Pour bien comprendre ce qui va suivre, quelques définitions sont nécessaires.
On dit d'ordinaire que les fonctions exercées par les membres d'une même société sont de deux sortes : que les unes sont sociales, et les autres privées. Celles de l'ingénieur de l'État, de l'administrateur, du député, du prêtre, etc., sont de la première espèce ; le commerce et l'industrie, c'est-à-dire les fonctions économiques (sous la réserve des monopoles), ressortissent à la seconde. A vrai dire, les dénominations ainsi employées ne sont pas irréprochables ; car, en un sens, toutes les fonctions de la société sont sociales, les fonctions économiques comme les autres. En effet, si elles ne jouent pas normalement, la société tout entière s'en ressent et, inversement, l'état général de la santé sociale affecte le fonctionnement des organes économiques. Cependant cette distinction elle-même, abstraction faite des mots qui l'expriment, ne laisse pas d'être fondée. En effet, les fonctions économiques ont ceci de particulier qu'elles ne sont pas en relations définies et réglées avec l'organe qui est chargé de représenter le corps social dans son ensemble et de le diriger, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément l'État. Cette absence de rapports peut se constater aussi bien dans la manière dont la vie industrielle et commerciale agit sur lui que dans la façon dont il agit sur elle. D'une part, ce qui se passe dans les manufactures, dans les fabriques, dans les magasins privés, échappe en principe à sa connaissance. Il n'est pas directement et spécialement informé de ce qui s'y produit. Il peut bien, dans certains cas, en sentir le contrecoup, mais il n'en est pas averti d'une autre manière ni dans d'autres conditions que les autres organes de la société. Il faut pour cela que l'état économique se trouve assez gravement troublé pour que l'état général de la société en soit sensiblement modifié. Dans ce cas, l'État en souffre et, par suite, en prend vaguement conscience, comme les autres parties de l'organismes, mais pas différemment. Autrement dit, il n'y a pas de communication spéciale entre lui et cette sphère de la vie collective. En principe, l'activité économique est en dehors de la conscience sociale ; elle fonctionne silencieusement ; les centres conscients ne la sentent pas tant qu'elle est normale. De même, ils ne l'actionnent pas d'une manière spéciale et régulière. Il n'y a pas un système de canaux déterminés et organisés par lesquels l'influence de l'État se fait sentir sur elle. Autrement dit, il n'y a pas un système de fonctions chargées de lui imposer l'action venue des centres supérieurs. - Il en est tout autrement des autres fonctions, Tout ce qui se passe dans les différentes administrations, dans les assemblées délibérantes locales, dans l'enseignement publie, dans l'armée, etc., est susceptible de parvenir jusqu'à ce qu'on a appelé le cerveau social, par des voies spécialement destinées à assurer ces communications, si bien que l'État est tenu au courant sans que les parties ambiantes de la société soient averties. De même, il y a d'autres voies du même genre, par lesquelles il renvoie à ces centres secondaires son action. Il y a entre eux et lui des échanges continus et divers. Nous pouvons donc dire que ces dernières fonctions sont organisées ; car ce qui constitue l'organisation d'un corps vivant, c'est l'institution d'un organe central et le rattachement à cet organe des organes secondaires. Par opposition, nous dirons des fonctions économiques dans l'état où elles se trouvent qu'elles sont diffuses, la diffusion consistant dans l'absence d'organisation.
Cela posé, il est aisé de constater que, parmi les doctrines économiques, il y en a qui réclament le rattachement des fonctions commerciales et industrielles aux fonctions direc- trices et conscientes de la société, et que ces doctrines s'opposent à d'autres qui réclament au contraire une diffusion plus grande des premières. Il paraît incontestable qu'en donnant aux premières de ces doctrines le nom de socialistes nous ne ferons pas violence au sens ordinaire du mot. Car toutes les doctrines qu'on appelle ordinairement socialistes s'entendent sur cette revendication. Assurément, ce rattachement est conçu de manières différentes suivant les écoles. Suivant les unes, ce sont toutes les fonctions économiques qui doivent être rattachées
aux centres supérieurs ; suivant les autres, il suffit que quelques-unes le soient. Pour ceux-ci, le raccord doit se faire au moyen d'intermédiaires, c'est-à-dire de centres secondaires, doués d'une certaine autonomie, groupes professionnels, corporations, etc. ; pour les autres, il doit être immédiat. Mais toutes ces différences sont secondaires et, par conséquent, nous pouvons nous arrêter à la définition suivante qui exprime les caractères communs à toutes ces théories : On appelle socialiste toute doctrine qui réclame le rattachement de toutes les fonctions économiques, ou de certaines d'entre elles qui sont actuellement diffuses, aux centres directeurs et conscients de la société. Il importe de remarquer tout de suite que nous disons rattachement, non subordination. C'est qu'en effet ce lien entre la vie économique et l'État n'implique pas, suivant nous, que toute l'action vienne de ce dernier. Il est au contraire naturel qu'il en reçoive autant qu'il en imprime. On peut prévoir que la vie industrielle et commerciale, une fois mise en contact permanent avec lui, affectera son fonctionnement, contribuera à déterminer les manifestations de son activité beaucoup plus qu'aujourd'hui, jouera dans la vie gouvernementale un rôle beaucoup plus important, et c'est ce qui explique comment, tout en répondant à la définition que nous venons d'obtenir, il est des systèmes socialistes qui tendent à l'anarchie. C'est que, pour eux, cette transformation doit avoir pour effet de placer l'État sous la dépendance des fonctions économiques, bien loin de les mettre dans ses mains.
DEUXIÈME LEÇON
. Å
Quoiqu'il soit journellement question du socialisme, nous avons pu voir, par les défini- tions usuelles qui en sont données, combien est inconsistante et même contradictoire la notion qu'on s'en fait communément. Les adversaires de la doctrine ne sont pas les seuls à en parler sans en avoir une idée définie ; les socialistes eux-mêmes prouvent souvent par la manière dont ils l'entendent qu'ils ne sont qu'imparfaitement conscients de leurs propres théories. Il leur arrive sans cesse de prendre telle ou telle tendance particulière pour le tout du système, par la simple raison qu'ils sont personnellement plus frappés de cette particularité que de toute autre. C'est ainsi qu'on a fini par réduire presque généralement la question sociale à la question ouvrière. On ne saurait trop penser à ces innombrables confusions si l'on veut se mettre dans l'état d'esprit nécessaire pour aborder d'un point de vue scientifique l'étude que nous allons entreprendre. En nous montrant ce que valent les idées courantes sur le socialisme, elles nous avertissent qu'il nous faut faire table rase de ce que nous croyons en savoir, si, du moins, nous voulons demander à la recherche que nous commençons autre chose qu'une pure et simple confirmation de nos préjugés. Il faut nous mettre en face du socialisme comme en face d'une chose que nous ne connaissons pas, d'un ordre de phénomènes inexplorés, et nous tenir prêts à le voir se montrer à nous sous un aspect plus ou moins différent de celui sous lequel on le considère d'habitude. D'ailleurs, à un point de vue non plus théorique mais pratique, une telle méthode, si elle était plus généralement pratiquée, aurait cet avantage d'apporter au moins une trêve aux passions contraires que soulève ce problème, puisqu'elle oppose aux uns comme aux autres la même fin de non-recevoir et les tient également à distance. Au lieu de mettre les esprits en demeure de choisir sur-le-champ une solution et une étiquette, et par conséquent de les diviser d'emblée, elle les réunit, au